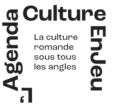Ces dernières années, nous assistons à une augmentation des propositions théâtrales ayant pour objet les violences sexuelles. Loin de n’offrir qu’une représentation de cette thématique, les pièces s’inscrivent plus globalement dans la lutte contre les violences sexuelles.
Texte et propos recueillis par Marie Butty
Le domaine cultuel, miroir de la société et de ses problématiques, n’échappe pas à la visibilisation croissante donnée aux violences sexuelles, grâce, en partie, au mouvement #MeToo. Ainsi, de plus en plus d’offres culturelles abordent cette thématique sociétale d’envergure par le biais de l’art et, notamment, du théâtre. Toutefois, plus qu’un simple reflet du monde, ces propositions théâtrales sont partie prenante d’une lutte au long cours amorcée il y a déjà des dizaines d’années. Comme le souligne la comédienne Wave Bonardi, qui a traité des conséquences des abus sexuels sur mineurs à l’âge adulte dans sa pièce DÉLIER en février dernier (www.l-agenda.ch/delier-wave-bonardi) : « Les personnes qui étudient les questions autour des agressions sexuelles constatent que nous oublions les chiffres, bien qu’ils soient aujourd’hui disponibles et maintes fois répétés. Le théâtre permet de toucher d’une façon différente et parfois complémentaire à ces données, à la lecture d’un article, d’un essai ou du visionnage d’un témoignage à la télévision. » Les pièces offrent ainsi une autre porte pour envisager un sujet qui, bien que de plus en plus abordé, reste un tabou soigneusement emballé dans des couches de silences par une société qui ne cesse de vouloir faire la sourde oreille. Mais qu’est-ce que le théâtre offre qui diffère d’autres moyens de représentations de la thématique ? La production culturelle possède-t-elle un pouvoir particulier qui l’inscrirait pleinement dans la lutte contre ce type de violence ?
Délier lors des représentations à l’Étincelle en février 2025
Photo: Sébastien Moritz
Le théâtre comme espace de visibilisation et de réflexion
Tout d’abord, la mise en lumière d’une thématique qui se veut silenciée par la société en son sein même est un geste fort. En faisant des violences sexuelles un sujet culturel, la société lui reconnait son importance et son existence dans l’espace public. Dans ce sens, la notion de tabou est mise à distance, puisqu’il s’agira de traiter la thématique et d’en parler. À ce propos, Nuria Manzur-Wirth, dont les représentations de la pièce Seuil débuteront en novembre à Montreux (voir encadré), explique qu’elle souhaite que sa mise en scène puisse aider à construire une prise de conscience du besoin de parler de ces sujets : « J’aimerais que la parole puisse se dénouer, qu’on puisse formuler un espace de réflexion autour du systémique qui s’inscrit dans ces situations, encore tellement fréquentes, pour ne plus avoir honte d’en parler. Il faut que l’on puisse nommer ces faits, en investiguant ce qui opère là-dedans, pour désamorcer les mécanismes d’emprise et surtout cesser d’en faire un tabou. » Toutefois, pour pouvoir apporter des éléments constructifs au débat, les productions théâtrales doivent aujourd’hui se réinventer : « Nous avons besoin de sortir d’un discours uniquement accusatoire, de transcender l’individuel, afin de créer un espace de questionnement qui implique les différentes personnes et aspects dans l’engrenage (y compris les potentiels agresseurs et le système à part entière, en commençant par celui de l’institution familiale jusqu’au corps normatif et légal de nos sociétés). Sans cela, les choses ne vont pas bouger ! C’est pour cette raison que la pièce se veut une invitation à explorer les possibilités de créer un dialogue sociétal. Rien n’est jamais tout blanc ou tout noir, il existe une multitude de zones grises qu’il s’agit d’aborder et de thématiser », souligne Nuria Manzur-Wirth. L’heure est donc à la mise en perspective, à la remise en question d’un système qu’il faut décortiquer pour en comprendre les rouages et transformer leurs fonctionnements. En ce sens, le théâtre offre une opportunité particulière, un levier pour s’interroger plus globalement.

BE – longing, Nuria Manzur-Wirth. Photo ©Julie Masson
On retrouve cette même volonté de sortir de l’individuel, sous une autre forme, dans la pièce DÉLIER. Dans son seule en scène, la comédienne a mêlé entre eux différents témoignages dont elle se fait la porte-voix. Le but de ce procédé était de pouvoir désindividualiser le témoignage et de l’inscrire dans un ensemble de voix, celle des victimes, afin de « dézoomer » et d’en faire une question sociétale. En effet, bien souvent, les récits de violences sexuelles sont réduits à des témoignages individuels, des cas exceptionnels, dans lesquels le bourreau serait un monstre qu’il conviendrait d’enfermer une fois pour toutes pour régler cette situation hors du commun. Toutefois, cette vision simpliste fait fi de l’ampleur de la problématique des violences : il ne s’agit pas de récits isolés, mais bien d’un problème systémique, ce dont la pièce témoigne avec brio. Ainsi, en plus de visibiliser un tabou, si ce n’est le plus grand, de nos sociétés, la création théâtrale permet une transformation et une prise de distance vis-à-vis de la thématique qui offre une ouverture systémique et appelle à la réflexion. Nuria Manzur-Wirth explique que dans les arts vivants, « le jeu en soi met en place une distance. On peut parler de choses bouleversantes, intriquées et complexes, pour jouer avec les possibilités de compréhension qui se déploient par le biais de cette distance. »
La symbolique de l’inversion des rôles
En parallèle de l’espace de réflexion, la mise au centre de la victime dans les représentations de récits de violences offre un espace pour une parole si longtemps silenciée et volée par plusieurs biais. Les pièces font de la victime le sujet, ce qui va à rebours du discours habituellement relayé dans la sphère publique, comme celui des médias par exemple, qui se focalise principalement sur l’auteur·ice en effaçant complètement les victimes du tableau. La parole des victimes est également dérobée par les violences elles-mêmes, qui sont souvent subies en silence sous l’effet de sidération. Parfois, plus particulièrement dans les cas de violences sexuelles sur mineurs, la parole est imposée par l’auteur·ice qui déforme les perceptions, notamment en qualifiant leurs actes « d’amour incompris de la société actuelle ». Les personnes concernées par les violences sexuelles sont reléguées au statut d’objet par leur agresseur·se, elles sont considérées comme des choses dont on se sert pour assouvir un désir de domination. Elles n’existent plus en tant qu’êtres humains. Ainsi, le fait d’être à nouveau sujet comporte une notion de reprise de pouvoir sur la parole, mais également sur un passage symbolique d’objet à sujet, ce qui constitue une symbolique forte. Clémence*, une des survivantes qui a confié son récit dans le cadre du projet DÉLIER raconte qu’elle s’est vraiment sentie actrice dans le projet. Il y a donc une véritable reprise de possession de sa propre histoire grâce à la représentation théâtrale.
Un effet thérapeutique ?
Au vu de la fréquence de ce type de violence, il y a également lieu de considérer l’impact potentiel de ces pièces sur le public. En effet, lors des spectacles, il y a de fortes chances qu’une grande partie de la salle soit directement concernée par ces violences. Assister à une représentation traitant de cette thématique peut avoir pour effet de prendre conscience que l’on n’est pas seul·e, que les ressentis suite à un abus sexuel sont valides et normaux. Wave Bonardi relève que le fait d’être spectateur·ice de ces récits est très légitimant pour une personne ayant subi des violences : « cela rend palpable cette chose insaisissable, cela traduit toutes les sensations ». En effet, mélanger les mots, les images et le corps permet à chacun·e de se reconnaître avec l’un ou l’autre de ces médiums, suivant sa sensibilité. La comédienne constate également que les personnes qui sortent de sa pièce ne sont pas abattues : « Elles sont touchées et affectées et viennent me remercier. Souvent, quand il y a une prise de conscience, les personnes se sentent très vite accablées, impuissantes, car elles ne savent pas qu’en faire. Avec une œuvre artistique, il y a déjà des pistes. Une personne m’a parlé de rage joyeuse, d’espoir, de transformation. » Cette puissance thérapeutique rejoint les propos de Clémence* : « Participer à ce projet a été une expérience très forte. Nous sommes plusieurs voix, portées par Wave, ce qui crée une sorte de communauté des survivantes. Quand on vit ce genre de chose, on se construit avec, seule dans son coin. Ce projet permet de se rendre compte qu’on a vécu des choses similaires et que nous formons un tout, une voix des survivantes. On appartient à quelque chose de plus grand qui se matérialise ici dans le jeu et la voix de la comédienne. On n’a pas toutes utilisé les mêmes mots, les mêmes expressions, mais c’est vrai que, plusieurs fois, je me posais la question : est-ce que c’est moi qui ai dit ça ? J’ai clairement ressenti des effets miroirs dans ce que j’entendais, qui n’étaient pas mes mots et mes citations. J’espère que d’autres personnes ont pu s’identifier à nos voix et que le message a été porteur d’espoir pour ces gens. »
Délier lors des représentations à l’Étincelle en février 2025
Photo: ©Sébastien Moritz
Dans une même perspective, Nuria Manzur-Wirth évoque la possibilité d’agir sur la culpabilité ressentie lors de telles agressions : « j’espère que cela puisse soulager la culpabilité car c’est une des choses que l’on traite peu. Dans la pièce, j’analyse la logique du désir, le rapport entre les personnes (qui est normalement un rapport de pouvoir et de force). Cela peut apporter une autre perspective pour mieux comprendre la structure du consentement ou du non-consentement et ainsi, peut-être, aider à ne pas s’en vouloir d’avoir ressenti, dans certains cas, un désir à un moment donné, sans avoir compris où ce désir pourrait mener. »
Un endroit de justice
Nous le savons aujourd’hui, la justice est souvent déceptive à l’endroit des victimes. Elle ne les entend pas, ne reconnait pas leurs vécus et les maltraite souvent par le biais des répétitions demandées des récits auprès des diverses instances, de la longueur excessive des procédures, de la possibilité de mise en place de procédures baillons par les agresseurs, des coûts exorbitants ou encore par des acquittements à répétition. Face à cette constatation, le théâtre peut incarner un espace de justice là où celle de l’état est défaillante. Tout d’abord, il offre une reconnaissance. À ce sujet, Wave Bonardi explique que le théâtre est un endroit public, assister à une pièce se vit de manière collective. La représentation des violences sexuelles dans cet endroit permet une reconnaissance collective du vécu, où les victimes ont droit à la parole et surtout sont entendues, contrairement aux procédures judiciaires. Vivre ces moments dans un cadre privé, avec sa famille ou ses amis a également une énorme valeur, mais le fait que cette thématique soit un objet culturel dont la reconnaissance se fait dans un endroit public offre déjà une reprise de pouvoir gigantesque qui pallie à ce que l’institution est incapable de fournir actuellement.
Toujours en lien avec la justice institutionnelle, Wave Bonardi ajoute qu’elle ose espérer que les représentations de plus en plus récurrentes de cette thématique dans le domaine culturel vont inévitablement atteindre l’espace judiciaire de manière indirecte. En effet, en se saisissant d’une thématique, les représentations ajoutent de la compréhension, des explications et sensibilisent le public, tout en démontrant qu’il s’agit d’un sujet d’importance pour la société. Ces évolutions du droit par le biais du domaine culturel ont bel et bien eu lieu, comme cela a été notamment le cas en France pour la littérature, puisque l’ouvrage Le Consentement de Vanessa Springora a été le déclencheur de l’évolution législative sur la protection des mineurs quant au phénomène d’emprise.
Des outils de médiation
Finalement, en plus d’offrir un espace de réflexion et de réparation, les pièces peuvent servir la prévention et l’éducation des plus jeunes. Comme le souligne Nuria Manzur-Wirth, le travail pédagogique pour prévenir ce type de violence est très important, surtout chez les petits : « il faudrait mettre en place des outils pour que l’articulation verbale de ces situations puisse se construire ; que les personnes adultes participent à la formulation d’une parole qui institue, chez l’enfant, la base d’une compréhension adaptée à son âge, dans le but de distinguer et nommer manifestement ses propres limites. » L’idée du projet Seuil s’accompagne d’une volonté de médiation qui envisage, notamment, des représentations dans les gymnases, suivies d’ateliers sous forme de bords de scène avec un·e psychologue spécialisé·e et un·e représentant·e du domaine légal. Ceci afin de travailler à la construction d’un espace de parole, de réflexion et d’échange sécurisé. Cette volonté est également présente dans le projet DÉLIER : « C’est une pièce que j’ai envie d’amener aux adolescents », nous confie Wave Bonardi. Elle ajoute qu’une telle pièce peut avoir un rôle préventif, notamment pour des thématiques comme le consentement. Dans cette perspective, la représentation des violences sexuelles par le biais du domaine culturel constitue une piste extrêmement intéressante dans la lutte.
Au-delà de l’art
Le choix de représenter les violences sexuelles au théâtre va donc bien au-delà de l’art. Il s’agit d’un autre moyen de lutte, d’un outil supplémentaire pour remettre le monde à l’endroit. Wave Bonardi relève qu’aller sur scène et dire ces mots-là est un acte tant poétique que politique. En ce sens, Nuria Manzur-Wirth conclut que, bien que le théâtre ne puisse pas changer le monde, il peut constituer une pierre à l’édifice de la lutte contre cette forme de violence, en (dé)montrant certains de ses mécanismes de coercition et de force.

Nuria Manzur-Wirth. Photo: ©Alain Wirth
Seuil
Cie les Eaux Courantes
- Du 27 au 30 novembre 2025
Décal’Quai, Montreux
Billets : www.petzi.ch
- En 2026 lors des festivals Cellules poétiques à Martigny et Poésie en arrosoir à Cernier
Seuil est un monologue joué par Nuria Manzur-Wirth, tiré de son recueil de poèmes Peaux (Éditions d’en Bas, 2023). Le poème parle d’un viol que l’autrice a subi à l’âge de 15 ans par un homme majeur, de deux fois son âge. Ce témoignage parcourt, à l’aide de la voix poétique, les sauts entre l’adolescente et la femme adulte, ce qui permet d’accompagner le public dans un espace de réflexion. Avec cette pièce, la comédienne met en lumière l’éveil du désir chez une adolescente, dans la douceur et l’innocence qui lui sont propres, les débuts de compréhension de la séduction, du rapport à l’autre, et les met en parallèle avec le désir adulte qui prend, chez lui, toute une autre forme et direction. Elle explore les zones grises et les dynamiques de pouvoir tout en relevant ce qui a été perdu : l’innocence.
DÉLIER
Reprise à la saison 26/27. Infos à venir: www.lahoule.ch

DÉLIER est un seule en scène qui traite des impacts à long terme des agressions sexuelles sur mineur·e·s, que ce soit sur le rapport à soi et aux autres, la vie affective et sexuelle ainsi que sur la santé mentale et physique. Un voyage entre parole documentaire issue d’entretiens menés auprès de survivants·es et parole poétique.
Le spectacle traite de l’adulte et non des abus en eux-mêmes. Il donne à voir des mues. Ici, il est question d’intégrité et même de notre intégrité collective. Quelle que soit notre histoire, nous avons tous·tes besoin et droit au pouvoir sur nos corps.
« Délier » est une langue. Une langue qui dit la fragmentation, qui refuse d’être indicible et lutte contre l’invisible.
Photo de haut de page: freepik